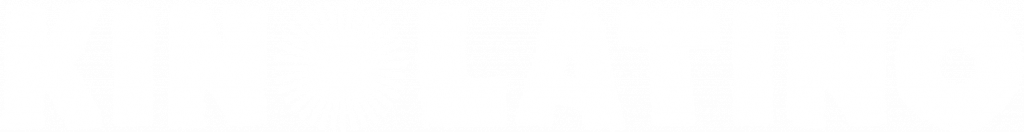A l’occasion du film “Argentine 1985”, réalisé par Santiago Mitre, voici une analyse du film. C’est aussi une analyse de la signification des procès des juntes militaires, de notre mémoire et de nos luttes.
Par Diego Sztulwark
Trois décennies après la publication d’Almirante Cero, une biographie non autorisée d’Emilio Eduardo Massera (inédit en français), cela nous permet de réfléchir aux modalités concrètes de reproduction de l’idéologie de la droite argentine dans la politique et au-delà. Sinistre amiral et membre de la première junte militaire de la dernière dictature argentine, une rationalité historique se condense autour de son patronyme, celle qui a animé le terrorisme d’État et l’indépendance militaire, qui tend à être actualisée par de nouveaux moyens.
En tant qu’officier de la marine argentine, Massera a hérité du rôle de l’armée “capitulée” – voir les livres fondamentaux de León Rozitchner : Perón, entre la sangre y el tiempo ; et Malvinas de la guerra sucia a la guerra limpia – incapable de concevoir les armes en termes de guerre de libération. À partir de la campagne du désert, et de la prise de conscience oligarchique du danger que représentait l’immigration prolétarienne européenne, les forces armées ont été formées à la répression interne, endoctrinées par la hiérarchie de l’Église catholique argentine – voir sur ce point l’étude non moins fondamentale d’Horacio Verbitsky sur l’histoire politique de l’Église catholique argentine. Cette marine qui, comme l’explique Alejandro Horowitz dans son livre Los cuatro peronismos, a agi comme le “dernier rapport” armé de la droite. De Rojas à Massera, il y a une continuité : le coup d’État de 55 ; le massacre de Trelew en 1972 ; l’ESMA.
Mais en plus d’un héritage, il y a une action fondatrice du droit. Massera a été un protagoniste de la constitution de cette forme d’État qu’Eduardo Luis Duhalde a appelé dans son livre El estado terrorista (l’État terroriste), caractérisé comme la tentative de sauver le capitalisme argentin de ses défis en sapant la légalité depuis le sommet de l’ordre juridique en faveur d’une clandestinisation de l’action publique (la Task Force, les disparitions) et en utilisant la torture comme méthode.
Mais à Massera, et c’est là le cœur de l’argumentation du livre Almirante Cero, la tentative de cette machine de guerre meurtrière de s’autonomiser des classes sociales qui lui ont confié l’usage des armes pour réaliser son propre programme politique et économique est clairement affichée. La puissance de feu du GT 3.3.2 ne se limitait pas à la “lutte anti-subversive”, mais aussi à la résolution de toutes sortes de conflits politiques au sein du gouvernement, mais aussi à la saisie d’entreprises et à la liquidation des obstacles personnels de Cero. Ainsi, des diplomates, des militaires et des hommes d’affaires ont été assassinés, membres ostensibles d’une classe bourgeoise qui sentait le danger qui la guettait.
Dans le cadre de cette stratégie d’autonomisation, Massera a imaginé la conception d’un nouveau mouvement politique capable d’hériter du péronisme par le biais de la prison et de l’aiguillon à bétail. Ce fantasme de diriger le mouvement de masse par la subjugation visait à combiner le double rôle que l’amiral s’arrogeait : gardien ultime des valeurs occidentales, et maître d’un péronisme qu’il entendait dompter en maintenant en prison les dirigeants syndicaux et Isabel Perón elle-même, tandis que des dizaines de militants montoneros restaient disparus sous son contrôle strict dans l’ESMA.
“la tentative de cette machine de guerre meurtrière de s’autonomiser des classes sociales qui lui ont confié l’usage des armes afin de réaliser son propre programme politique et économique”.
Cette machine de guerre d’ultra-droite a toujours eu un caractère international grâce à l’intégration de Massera comme membre dirigeant de la P2 de Licio Gelli, une loge de l’anticommunisme des patrons européens avec le soutien de la banque du Vatican, qui a donné à Massera des millions pour financer l’achat d’armes pour la guerre contre le communisme.
Athée et partenaire de l’Église catholique, Massera donne à son mouvement politique le nom de “démocratie sociale” et fait appel à des écrivains pour composer ses discours, notamment Hugo Ezequiel Lezama, rédacteur en chef du journal masseriste Convicción.
Massera, en tant qu’incarnation de l’impulsion autonomiste de la machine de guerre vis-à-vis de la classe dominante, est inséparable de l’illusion qu’une fois ses victimes et la société qui les observe désarmées, elles se soumettront à sa reconnaissance sous forme de respect mutuel et de reconnaissance du vainqueur. Cette maladresse historique, démentie par la combativité non-violente des proches, des organisations et du militantisme social, n’est pas une simple erreur de calcul, mais un symptôme de l’impossibilité de la lucidité historique émergeant de l’illégitimité politique.
Si la droite est le gouvernement de “l’état d’exception”, qui vit de l’éclatement de l’ordre juridique – séparation et réarticulation de la force et du droit – en fonction de la défense et de l’extension des rapports sociaux capitalistes, faisant de la démocratie un moyen d’organiser politiquement les rapports de domination, il faut dire aussi que cet éclatement ne se fait pas toujours de la même manière.
Et s’il y a une chose à laquelle nous devons penser, c’est à cette manière différente. Si la marine gorille de 55 a tenté de briser le lien péroniste entre la démocratie parlementaire et le pouvoir syndical au moyen d’une proscription fortement raciste, reportant les élections à un avenir populaire, la marine de Massera a participé à un plan politique différent, dans lequel l’ensemble des forces armées s’est engagé dans le programme des classes dominantes et de la direction de l’Église catholique, visant à couper définitivement toute option politique basée sur la classe ouvrière argentine. Le coup d’État de 1976 était prévu comme le coup capable de mettre fin aux coups d’État. Et l’État terroriste comme fin de l’État autoritaire dont la fragilité résidait précisément dans son incapacité à faire cohabiter le recours fréquent au coup d’État et la constitution d’un commandement légitime. Dans une inversion typique du Marx du 18 Brumaire, Uriarte écrit que “comme contrepartie de cette militarisation de la vie politique, les Forces Armées ont souffert de la politisation de leur vie institutionnelle”, multipliant les antagonismes et les conflits issus des conflits sociaux et de classe. Le coup de mano était une affaire si facile, ne dépendant que de la conviction d’un certain nombre d’officiers, que même les syndicats péronistes le pratiquaient.
“Les forces armées dans leur ensemble étaient engagées dans le programme des classes dirigeantes et de la direction de l’Église catholique visant à couper définitivement toute option politique basée sur la classe ouvrière argentine”.
La goutte d’eau qui a fait déborder le vase, comme on dit, c’est l’année 69. Le Cordobazo a été l’explosion de la contradiction entre un “pays officiel” (un État qui planifie technocratiquement sa survie) et un “pays réel”, effet d’une longue transformation des rapports sociaux (nouvelle industrialisation/nouveau prolétariat industriel/capital étranger/nouvelle classe moyenne exceptionnellement éclairée). A cela s’ajoute l’influence des processus mondiaux : révolution cubaine/décolonisation/guerre du Vietnam). 69 a été pour les siens et leurs ennemis l’année qui a incarné le fantôme révolutionnaire, et a installé le modèle insurrectionnel pour les militants ouvriers et étudiants, avec le spectre conséquent du renversement total de la structure militaire. La réponse au Cordobazo est entre les mains du général Lanusse : retrait des forces armées, retour d’exil de Perón et élections. Le Cordobazo a servi d’introduction à une action de masse contre le dispositif militaire de la proscription. Et son effet fut la fin de l’interdiction, et les préparatifs pour accueillir à nouveau le péronisme dans le jeu politique (le massacre de Trelew fut pour Uriarte la tentative de la Marine de conditionner cette ouverture du jeu). En d’autres termes, le péronisme était considéré comme une “police d’assurance” au moment de “la plus grande militarisation civile connue à l’époque” (Ezeiza), tout en donnant libre cours à l’AAA et en préservant les forces armées pour la solution finale.
Le coup d’État de 1976 et la prise du pouvoir par la junte militaire ont élevé Massera, issu de la classe moyenne, sensible à la poésie dans sa jeunesse et lecteur de Martínez Estrada, au sommet du pouvoir politique. Formé pendant des années dans les services de renseignement de la marine (SIN), Massera a formé et dirigé la task force 3.3.2 qui opérait depuis l’ESMA, l’un des plus grands centres de détention clandestins du pays. “Cero” était son nom de guerre, lorsqu’il dirigeait la bande qui entrait la nuit dans les maisons des militants, mais aussi pour effectuer des séances de torture. Le jour, il reçoit les honneurs d’un chef d’État, mais au petit matin, il est enlevé, volé et tué.
La guerre des Malouines elle-même, avec laquelle Massera a flirté au pouvoir, mais dans laquelle il a joué un rôle marginal, n’a été que l’extension à l’ensemble du commandement militaire d’un fantasme collectif – c’est-à-dire, en somme, l’autonomie de la machine de guerre de droite – capable de maintenir le groupe en armes au pouvoir une fois le programme antisubversif consommé. Ensuite, la machine de guerre s’est proposée comme l’avant-garde armée de la défense d’un Occident qui non seulement ne reconnaissait pas ce rôle, mais se demandait aussi si les commandants militaires, substituts de l’État et de la classe dirigeante, établiraient un jour des liens étroits avec l’URSS. La défaite des forces armées, à ce moment-là en quelque sorte souhaitée par les classes dirigeantes argentines, a donc été l’œuvre de forces armées ancrées dans l’Occident capitaliste et chrétien (et le rôle de frein idéologique du pape Jean-Paul II, tant dans le conflit du Beagle que dans celui des Malouines, ne doit pas être sous-estimé).
Massera a déclaré lors du procès que son nom de famille serait justifié à l’avenir. Son erreur a été de croire que la défaite militaire de la guérilla signifiait le désarmement moral du camp populaire, qui s’est réorganisé de manière tout à fait inattendue pour lui sur la base du mouvement des droits de l’homme, puis d’innombrables organisations sociales et syndicales. Cette erreur, cependant, n’est pas une simple distraction. La machine de guerre de la droite ne vise que la suppression. Alors que les Mères de la Place de Mai n’ont jamais affronté le pouvoir en ces termes. C’était leur force inattendue.
Son erreur a été de croire que la défaite militaire de la guérilla signifiait le désarmement moral du côté populaire, qui s’est réorganisé de manière tout à fait inattendue pour lui, en commençant par le mouvement des droits de l’homme et ensuite d’innombrables organisations sociales et syndicales”.
Dans une scène du film Argentine 1985, le procureur Strassera (Ricardo Darín) va voir avec scepticisme son ami plus âgé, le Russe (Norman Brisky). Il a été chargé de poursuivre les juntes militaires qui ont dirigé le pays pendant la dictature, mais il ne pense pas que le système judiciaire, la politique argentine ou lui-même soient à la hauteur de cette tâche. El Ruso l’encourage avec l’argument suivant : de temps en temps, même dans le pire des systèmes (il fait référence à l’État), une fissure s’ouvre et, si l’on en profite, il est possible de provoquer un changement transcendantal. Peu après, nous voyons Massera et les autres membres des Juntas comparaître en silence devant un plaidoyer qui se termine par une citation du rapport Nunca Mas de CONADEP. Qu’est-ce qui est sanctionné dans ce procès ? Certainement pas le programme triomphant du soi-disant processus de réorganisation nationale, ni le vaste réseau de ses bénéficiaires et complices dans l’armée. Si Massera a commis une erreur de perspective dans sa défense (déclarant aux juges que si “nous avions perdu, nous ne serions pas ici, ni vous ni nous”), c’est qu’il n’a pas perçu de manière adéquate à quel point ce qui était réellement condamné était l’autonomisation de la machine de guerre de l’ultra-droite.
Cette interprétation de l’Argentine 1985 n’est-elle pas à la fois la plus intéressante (parce qu’elle est actuelle) et la plus contestable (parce qu’elle est insuffisante) ? Désactiver la fiction négationniste qui se met en branle dans chaque autonomisation des machines de guerre de la droite est aussi important que de comprendre que cette désactivation est impossible à résoudre par les moyens exclusifs du droit écrit. Ce jugement, comme nous le savons tous, doit plus qu’il ne l’admet à la défaite militaire des Malouines et des Mères de la Place de Mai. Le succès d’Argentine 1985 est de renouveler l’écoute des mots de “violence lâche” et de “perversion morale”, lus par Darín-Strassera, en établissant les mises à jour nécessaires. Mais ce faisant, ils nous renvoient à la question des conditions extra-juridiques (proprement politiques) que cette écoute doit activer pour arrêter ou détruire l'”indépendance armée” de l’ultra-droite actuelle.

La chute politique de Massera (qui a fini par être accusé de 83 meurtres, 623 privations illégales de liberté, 267 tortures, 23 réductions en servitude et 11 enlèvements de mineurs, entre autres crimes) et la solitude définitive de Videla, n’est rien d’autre que l’envers de l’autonomie imaginaire de la machine militaire par rapport au bloc des classes dirigeantes dont elle est issue. Double délire, en tout cas, parce qu’ils n’ont jamais atteint un support social qui pourrait légitimement les soutenir non plus. Videla priant la Vierge, rancunier d’avoir été abandonné par ceux qui, à l’époque, l’ont accompagné et encouragé, et Massera abhorré pour avoir été “responsable de crimes contre la bourgeoisie”, constituent une restitution du principe de réalité à laquelle les Mères de la Place de Mai ont contribué comme nulle autre. Lezama lui-même, déçu par “el negro” lorsqu’il constate – en 1988 – l’enrichissement brutal de Cero, cesse de lui rendre visite. Massera, écrit Uriarte, est tombé en disgrâce pour les mêmes raisons qui l’avaient amené au sommet du pouvoir : la croyance que “les armes et le pouvoir nu” peuvent se substituer “aux véritables relations de pouvoir” et pour “s’être placé d’innombrables fois en marge de la légitimité et de la légalité socialement acceptée”.
Dans une autre tournure de l’argument, Uriarte pense que Massera n’a pas réalisé les termes de sa propre victoire, qui consistait à ce que ses adversaires parlent des droits de l’homme et non de la lutte des classes à la fin de la dictature. À mon avis, Uriarte lui-même ne saisit pas dans cette phrase à quel point la lutte des classes dans l’Argentine post-dictature s’est régénérée non pas malgré mais grâce à la singularité que le discours des droits de l’homme a adoptée dans ces terres. Uriarte met l’accent sur le mutisme des hiérarques militaires pendant le procès comme une conséquence naturelle de leur politique de disparitions clandestines : ne reconnaissant pas publiquement leurs propres actions répressives, ils étaient condamnés au déni ou au silence comme seul recours face aux témoignages des victimes. La phrase principale de la défense de Massera, écrite par Lezama, résume la seule chose que les génocidaires ont été capables d’articuler depuis lors : “Personne n’a à se défendre d’avoir gagné une guerre juste”. Mais si la dictature triomphait, et que le silence de la défense ne signifiait qu’une faiblesse momentanée – imposée par l’illégalité des médias – il serait encore possible de croire, selon les propres mots de Cero, que “lorsque la chronique s’effacera parce que l’histoire deviendra plus claire, mes enfants et petits-enfants prononceront avec fierté le nom de famille que je leur ai laissé”. Ce ne fut pas le cas, et ce parce que la chronique ne s’est pas effacée mais s’est précisée, non pas dans la défaite mais dans la résistance, dans l’extraordinaire conversion de la lutte pour les droits de l’homme en un humus sensible à partir duquel remettre en question le projet triomphant de la dictature.
Ce qui est intéressant, en tout cas, ce n’est pas tant ce que croit Almirante Cero (ou, d’ailleurs, l’Argentine de 1985), mais ce que, même dans cette dissidence, nous pouvons y lire aujourd’hui, trois décennies après sa publication et 15 ans après la mort de son auteur – un journaliste qui a travaillé dans diverses rédactions : de Convicción à Página 12 – une série d’observations historiques peut-être plus utiles pour notre présent que pour le sien. Et notamment les suivantes : Massera, malgré toute son habileté politique, a toujours manqué d’une base sociale, une limite qui accompagne encore aujourd’hui l’ultra-droite en Argentine. Il disposait du maximum de pouvoir tant qu’il avait la puissance des armes, mais du minimum de légitimité populaire pour une politique capable de transcender le camp clandestin de la détention et de la torture. C’était sa limite, même quand il était le seigneur de la vie et de tant de gens. La droite peut être et est violente et puissante, délirante et meurtrière, oui. Mais ce qu’elle ne doit pas réaliser – et c’est là le véritable défi pour tous ceux d’entre nous qui comprennent que la démocratie ne peut être réduite à être juste le contraire de la dictature, une simple “indépendance des pouvoirs” – c’est l’articulation entre ses machines de guerre et un soutien de niveau mouvement de masse.
Partagez cet article