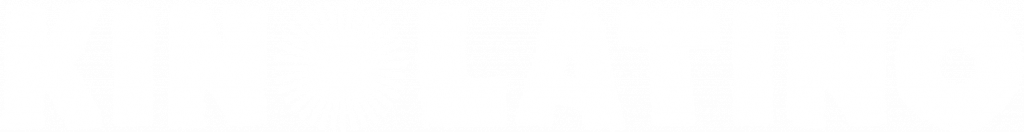Analyse Sara Gómez, première cinéaste cubaine Elle était femme et noire, mais ces caractéristiques n’étaient pas un obstacle pour entrer dans le panthéon du cinéma. Au contraire, Sara Gómez, est la première réalisatrice du cinéma de l’Institut cubain d’art et d’industrie cinématographiques (ICAIC). Par Raquel Sierra / CIMAC / SEMLAC 30 décembre 2022 Elle est morte jeune, à seulement 32 ans. Cependant, son travail perdure. Dans les années 1960 et 1970, Sara a d’abord réalisé des documentaires, puis des fictions, comme De cierta manera (D’une certaine manière). Son travail documentaire des années 1960 comprend des titres tels que Sobre horas extras y trabajo voluntario (Sur les heures supplémentaires et le travail bénévole), La otra Isla (L’autre île), Una Isla para Miguel (Une île pour Miguel) et Mi aporte (Ma contribution), qui, de son point de vue, examinent les changements sociaux qui ont suivi le triomphe de la révolution cubaine en 1959 et leur influence sur la vie des gens. En blanco y negro (En noir et blanc), traite des préjugés raciaux, de la discrimination, de la marginalité et de ses conséquences sur les familles, du machisme, de la rupture avec le passé et des programmes sociaux visant à améliorer la vie et la dignité des hommes et des femmes cubains. Les thèmes et les problèmes qu’elle a choisis, le traitement qu’elle leur a réservé et l’originalité de son approche l’ont placée à l’avant-garde à l’époque et aujourd’hui, dans le contexte de la société actuelle, nombre de ses messages sont contemporains. Pour Jorge Fernández, vice-recteur de l’Instituto Superior de Arte de La Habana, son travail est celui d’artistes qui anticipent, qui transcendent leur époque. “Elle ne s’est pas contentée de rester dans le langage du cinéma, son langage était assez avant-gardiste et transgressif pour son époque. “L’œuvre de Sara Gómez continue de dialoguer avec ce qui se fait dans le jeune cinéma, dans le documentaire et la fiction cubaine”, a ajouté M. Fernández lors du colloque “Sara Gómez : imagen múltiple”, organisé à La Havane. Pour Sandra del Valle Casals, chercheuse au Centre Juan Marinello et présidente du comité organisateur, l’événement a rendu hommage au travail et à la figure non seulement de la première femme à avoir réalisé un long métrage à l’ICAIC, mais aussi de celle qui a porté au cinéma des questions d’actualité. La réunion a également permis d’apprécier les films cubains dans une perspective de genre, “car nous considérons qu’il est important d’élargir le spectre analytique et de révéler les constructions de genre qui se manifestent dans les films cubains”, a déclaré Mme del Valle. “L’œuvre de Sara Gómez est très pertinente en raison des questions qu’elle a abordées en tant que femme, femme noire et révolutionnaire. Il y a en elle une préoccupation pour le projet social de la révolution cubaine à partir de nombreuses perspectives, et c’est un héritage comme une analyse de cette réalité”, explique-t-elle. Selon Del Valle, il y a chez cette réalisatrice une recherche et une perspective anthropologique et sociologique pour aborder la réalité de son époque. Il y a des aspects qui sont un produit de son époque, mais il y en a d’autres qui sont proches de la maison. “Le cinéaste cubain Tomás Gutiérrez Alea avait l’habitude de dire qu’il était heureux lorsque son œuvre vieillissait, car cela signifiait que les problèmes qu’il avait soulevés avaient été surmontés. Dans les thèmes des films de Sara, il y a des histoires qui n’ont pas été surmontées, et c’est pour cette raison, entre autres aspects, qu’elle est toujours d’actualité”, a ajouté le spécialiste. Pour l’universitaire canadienne Susan Lord, elle était “une femme très courageuse, très avancée pour son époque en termes de possibilités de changer les relations entre les différents groupes sociaux”. “Il y a encore peu d’œuvres aujourd’hui avec cette imagination, cette façon de filmer pour rendre le monde plus démocratique”, ajoute-t-elle. “Elle fait partie du groupe d’avant-garde. Son travail peut donner au monde d’aujourd’hui, plein de globalisation, des moyens d’inventer des relations et de faire un pont, un dialogue entre les aspects éthiques, esthétiques et politiques”, a-t-elle déclarée. SARA, IMAGE MULTIPLE Inés María Martiatu, écrivain et amie de Sara, a eu le privilège de la connaître depuis son enfance. Ensemble, elles ont étudié le piano et le journalisme, et ensemble, elles ont intégré un séminaire de recherche, où ils avaient pour professeurs des intellectuels cubains pertinents. “Elle a toujours été très consciente de ce qu’elle faisait ; délibérément, son cinéma était inquisiteur, c’est pourquoi il est très spécial, très à elle”, dit-il. “Lorsqu’il y a eu des problèmes avec la première de De cierta manera, elle a emmené la pièce Al duro y sin careta, basée sur le film, au théâtre, ce qui a été un grand déclencheur. Les gens qui n’étaient jamais allés au théâtre le faisaient pour voir quelque chose qui reflétait leur réalité”, se souvient Mario Balmaseda, le protagoniste du film. “Sara a transféré son propre contexte au cinéma. Elle s’est placée au milieu des problèmes, sans prendre de distance. Elle n’a pas mis en place une histoire, elle a utilisé le témoignage des gens, le drame de leur monde, loin du discours officiel sur la façon dont ils doivent se comporter ; elle a mis sa vie en jeu avec elle-même, elle a pris des risques artistiques et émotionnels”, ajoute-t-il. De l’avis du cinéaste Jorge Luis Sánchez, réalisateur du récent film cubain primé La historia del Beny, “Sara n’est pas reproductible et personne d’autre n’a pu faire le genre de films qu’elle a réalisés. Elle est une cinéaste et non une documentariste, terme qui tente de réduire le travail des cinéastes et de cacher leur qualité. Elle est à la pointe de l’avant-garde”. D’UNE CERTAINE MANIÈRE Dans le premier long métrage de Sara, De cierta manera, un enseignant est envoyé pour travailler dans un endroit où un bidonville a été démoli et où des maisons offrant de meilleures conditions ont été construites, dans le but de transformer la réalité et la mentalité. L’enseignant entame une