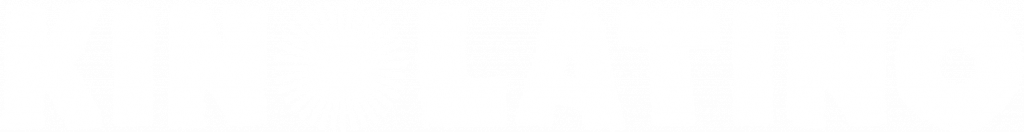Entretien avec Fabián Suárez, réalisateur de Caballos (Horses).
Par Dean Luis Reyes
Fabián Suárez n’est pas un grand parleur. Son truc, c’est l’écriture, comme on le verra dans ce qui suit. Depuis que j’ai vu Caballos, son premier film, le torrent de questions qu’il a provoqué en moi m’a conduit à élaborer ce questionnaire. Mon interlocuteur a pris son temps, mais la longueur et la finesse de ses commentaires m’ont confirmé qu’un dialogue écrit était le moyen d’affronter des questions qui dépassent le cadre filmique.
Car avec Caballos, nous nous trouvons face à une première œuvre qui non seulement déploie la force narrative de Suárez, déjà vue dans ses courts métrages Kendo Monogatari et Fiodor en el fiordo, mais aussi l’univers lyrique qui englobe aussi bien son œuvre poétique que ses textes dramatiques. Dans chacun d’eux, il y a une attitude qui va au-delà des mots et des gestes, qui transcende les images et veut montrer l’esprit d’une étrange époque.
Caballos est basé sur un texte pour la scène, écrit il y a près de dix ans, primé en 2008 puis publié. Pourquoi traîner ce projet, ses personnages et ses motifs, pendant tant d’années pour en faire un long métrage ?
Mon professeur Eliseo Altunaga dit que les obsessions ne se discutent pas. Pour moi, cette expression a toujours ressemblé à une sorte de caprice, juste parce que ; le terme perreta (colère) peut aussi être un parallèle. Pour l’instant, je pourrais vous dire qu’il s’agit d’une Obsession (avec une majuscule, comme ce parfum Calvin Klein qui ravit et rend fou, mais non ; le mieux serait d’étudier ces questions auxquelles je n’ai même pas donner de forme cohérente dans ma tête, et ainsi pouvoir vous répondre et m’éclairer en même temps).
J’étais très malade, alité et incapable de marcher pendant trois mois à cause d’une blessure à la colonne vertébrale, lorsque j’ai lu cette biographie de Robert Mapplethorpe qui circulait, publiée par Circe (écrite par Patricia Morrisroe), avec un autoportrait du photographe très captivant sur la couverture. C’était en 2005 et j’avais 23 ans ; mes lectures, mes envies et ma projection en tant qu’écrivain débutant étaient différentes. Lorsque j’ai terminé ce livre, quelque chose que je ne peux pas décrire avec des mots — et il vaut mieux que je n’essaie pas — a commencé à s’installer en moi ; un besoin de réaliser, avec le matériel qui m’était offert à l’époque, disons un “perreta artistique”.

À l’époque, j’étais en troisième année d’art dramatique à l’ISA (Instituto Superior de Arte) et je devais présenter une pièce pour le semestre. J’ai donc écrit une petite pièce avec quatre personnages et un seul lieu appelé Caballos; au ton minimaliste (ou si vous préférez, “à faible intensité dramatique”) ; avec des caractéristiques performatives plutôt que dramatiques, selon mon professeur Nara Mansur, qui m’enseignait à l’époque ; et plein de parlements jeunes et véhéments que je n’aime plus tellement maintenant.
Cette pièce relatait un moment très précis de la vie de Mapplethorpe, le moment qui m’a le plus captivé dans cette biographie : l’instant magique où lui, un photographe en herbe jouant à l’artiste, a fait le portrait de Patti Smith pour la couverture de son premier album intitulé Horses. En y réfléchissant, l’œuvre et le film auraient dû s’appeler Monstres, n’est-ce pas ? Ce sont les premières consonances, les premiers battements. Ensuite, j’ai continué à écrire des pièces et à étudier le théâtre jusqu’à ce que j’entre à l’EICTV (École internationale de cinéma et de télévision de San Antonio de los Baños), où j’ai suivi une formation de scénariste. Les chevaux ont donc été oubliés dans l’écurie pendant quelques années.
Lorsque j’ai décidé de réaliser mon premier long métrage, quelque chose m’a fait retourner dans ces enclos que j’aimais tant, j’ai découvert que les obsessions avaient réussi à survivre aux crues qui sont passées sous le pont (quand je dis quelque chose, je ne parle pas du vent ou des vagues, de quelque chose qui arrive tout simplement ; non, je me réfère à des thèmes inhérents dont on minimise toujours l’importance, parce qu’ils ne comptent que pour soi et qu’une certaine pudeur tend à les diminuer). J’ai su immédiatement que l’opération de réécriture annihilerait la pièce destinée au théâtre, parce que je voulais que ce souffle, ce quelque chose dont je parle, éclose dans un passé et un futur inventé dans mon pays, avec des personnages semblables aux vrais, dans ces rues, qui les toucheraient mais ne les imiteraient pas. L’opération de réécriture a donc été double : dans les formats et dans les intentions.
Dans le sédiment du film transparait toute cette recherche : les photos de Mapplethorpe, les chansons de Patti Smith, le New York que je ne connais pas, les tulipes que je connais, les mécènes queer millionnaires comme Sam Wagstaff, Warhol et la pop, les corps noirs en argent en pellicule, les poèmes, les collages, les nuits dans les parcs, les banlieues, les expositions et tout un univers très suggestif pour moi. C’est pourquoi, lorsque j’ai décidé de le situer à La Havane, j’ai essayé d’effacer toutes les conditions biographiques pour ne rester qu’avec ce plectre, avec l’électricité, avec ces liens souterrains et personnels que chacun de nous établit, non seulement avec l’art, mais aussi avec la Vie.
Quelle importance revêtent pour vous l’œuvre et la figure de Robert Mapplethorpe ?
Beauté et destruction. Amitié et malaise. Choix de vie, défense de ce qui est différent, de ce qui est authentique. Vivre pour ce qui vous tue ; pour ce qui vous tue artistiquement et personnellement. Je n’ai, par exemple, pas ressenti cela pour le cinéma ou le théâtre. Par conséquent, je me considère comme un cinéaste, je me considère comme un dramaturge… mais pas comme un artiste, une condition que j’aimerais atteindre. Le mot Art, le mot Artiste, aujourd’hui ont trop de puanteur, ils puent, ils empestent. Il y a dans cette ville beaucoup d’ordures (je veux dire, de laiton et d’artistes ; dans ce cas, les deux sont métalliques.) Comment peut-on gagner sa vie en disant “je suis un artiste”, “je suis un poète”, en brandissant ces bannières que les écrivains de gazettes de toutes sortes ont tendance à brandir ? Mais, mon dieu, comme peux-t-on peindre sans vergogne. En ce moment, j’ai beaucoup de noms en tête, autant que les chevaux de cette chanson de Patti Smith ; nous vivons dans un pays de simulateurs, les figures gracieuses des snobs sautent à chaque coin de rue. Je pense que l’insolence artistique est proche des génies qui ne pensent pas être insolents ; la provocation reste dans le domaine du dilettante et donc dans les mains de l’interprétation. Trop de prosélytisme vide et personne ne fait exploser une grenade dans un coin. Correction, une grenade artistique. Il me reste Robert Mapplethorpe et la malédiction de ses yeux verts profonds. Il faut brûler vers l’intérieur. Plus le cœur est chaud, plus le caillot que tu vomis est vrai.
Mais sans doute ce qui m’attire le plus dans tout l’univers mapplethorpéen, c’est ce qu’un sémioticien a appelé la “politique du corps” ; son regard sur le corps. Non pas le corps en tant qu’objet intervenu dans les performances réchauffées. Non. Ni le corps comme une bannière, le corps comme une barricade, le corps comme un puits de significations. Je pense que les véritables gestes politiques de la contemporanéité ne se trouvent plus ni dans les thèmes ni dans les formes ; l’expérimentation elle-même les a usés, au point de rendre suspectes les ressources que nous croyions autrefois artistiques. Pour moi, ce qui est vraiment politique, c’est le corps dépouillé de ses défauts artistiques et politiques ; un corps que je comprends comme étant textuel, naïf, le corps du désir. Tout ce que je fais dans la vie essaie, essaie d’améliorer l’intuition. Mais ma tête est un animal trop éduqué, trop romanesque, plus si naïf… et c’est là que se déroule mon vrai combat de cinéaste et d’écrivain. Le point équidistant où la politique fait valoir ses raisons et où l’art, sentimental, se défend. Descartes, peut-être ?
Le désir d’un jeune acteur cubain de jouer Robi, qui est à la fois lui-même et à la fois Mapplethorpe, est à peine une provocation et un enthousiasme. Le geste indéniable, à mon avis, est de proposer un corps différent (complexe dans la mesure où il peut l’être), ni rigoureusement politique ni absolument sentimental, qui puisse interagir avec ce que nous appelons la “réalité cubaine” ; presque toujours trop concrète et concret (béton), presque toujours trop ancrée, presque toujours trop préoccupée par l’ici et maintenant.
J’ai l’impression que tout ce qui entoure Caballos est brodé entre l’élégie et la dimension tragique de cet univers. Je sens même que votre film contient l’ambition de célébrer un autre type d’héroïsme, celui de la synchronicité recherchée entre le mot et la vie. Et comme tout premier film contient une déclaration de principes, y a-t-il ici une exaltation de la vie comme se jetant dans le vide de soi, quelles qu’en soient les conséquences ?
Voyez-vous, je suis plus modéré ; les exaltations ne sont pas mon fort et, d’une certaine manière, j’ai aussi peur du tragique, de croire que quelque chose de fatal se profile au-dessus de nos têtes. Je suis agacé par les gens qui se plaignent tout le temps de ce qu’ils ont, c’est-à-dire ce qu’ils ont obtenu et même mérité pour avoir été la personne qu’ils ont choisi d’être. L’homme n’est pas seulement lui et ses circonstances. L’homme, c’est aussi lui-même et ses décisions. Bien sûr, Caballos célèbre un autre type d’héroïsme ; je dirais le vestige d’un héroïsme, d’une période héroïque vécue par ce pays. Avec quel type d’esprit peut-on s’assimiler à Camilo Cienfuegos ? Je trouve terrifiant de devoir supposer que l’on doit ressembler à un certain héros : serons-nous comme le Ché ? Et je me demande pourquoi je ne peux pas être comme mon père, mon oncle ou mon frère, qui sont les personnes que je connais. Ne sont-ils pas aussi les héros de notre quotidien, ceux qui me sauvent et m’encouragent minute après minute ? Mon film parle, entre autres, de ruptures générationnelles et de modes de pensée contradictoires ; il articule certains dialogues avec l’histoire cubaine que les pouvoirs en place n’ont pas laissé apparaître à la surface. Les chevaux d’aujourd’hui ne ressemblent pas nécessairement aux chevaux d’autrefois. Nous n’avons pas brouté dans les mêmes pâturages, bien que l’écurie de base soit la même : Cuba.
Ce qui m’attriste vraiment dans ma génération, c’est l’apathie. Si nous regardons la racine grecque : absence de passion ; passion pour quoi ? passion pour décider d’être et de ressembler à qui on veut ; passion pour ne pas devenir froid, calculateur (la froideur est l’un des antonymes) ; ou bien la passion nous rend-elle dangereux ? Il n’y a pas d’autre moyen de faire des révolutions qu’à partir d’une passion absolue. Malheureusement, ce pays a dérivé de l’enthousiasme révolutionnaire vers la froideur du je-m’en-foutisme, la paresse et l’indolence. C’est pourquoi mes personnages ne sont pas volitifs ; la politique et le pouvoir lisent la réalité, disons, d’une manière aristotélicienne. C’est pourquoi nous devons donner à Aristote et à tous les sanctum sanctorum qui sont élevés autour du nom d’Aristote, des drames et autres conneries. Pour cette raison, Caballos célèbre peu de choses ; je reconnais qu’il est quelque peu mélancolique, hiératique et maussade. En tout cas, ce ne sont pas des défauts, mais des particularités du film. La passion n’enveloppe que rarement ces personnages, et quand il y en a un soupçon, ils sont paralysés et figés par le découragement.
Je pense que, contrairement à la croyance populaire, les Cubains d’aujourd’hui sont assez dépassionnés. Si Caballos contient une quelconque déclaration de principes, ce ne sera jamais une déclaration artistique ; cela m’intéresse moins. Un cri, cependant, dans l’espoir que les frustrations (de quelque nature qu’elles soient) ne finissent pas par nous transformer en un peuple cynique et sans cœur, avec un dégoût perpétuel. Je ressemble à un annonceur évangéliste dans un programme radio. Je pense effectivement que le film manie “une exaltation de la vie” comme vous le dites. Je ne sais pas s’il s’agit de “se jeter dans le vide de soi” comme vous le dites ; plutôt à l’intérieur de soi, là où résident les vérités les plus authentiques, parce qu’elles sont les siennes. Peu importe, pas les conséquences, comme vous dites, mais les décisions. Moi, Fabián Suárez, je choisis de ne pas être apathique, même si mon film souligne cette condition générationnelle dans laquelle j’ai vécu, ce temps de l’apathie et des ambitions éteintes, cette fin de l’héroïsme exalté. C’est à chacun d’entre nous de proposer les dialogues politiques que nous voulons avoir pour dîner à notre table.

Il est curieux que vous revendiquiez du film Mémoires du sous-développement de Tomás Gutiérrez Alea comme une influence dialogique, alors que les références les plus proches dans Caballos semblent être certains films d’auteur européens (Ossang, Miguel Gómez, Lantinos, Costa). L’influence, dans votre cas, est-elle plus lyrique que thématique ?
J’espère ne jamais ressembler aux circonstances dont je suis issu. Je ne sais pas comment expliquer pourquoi. Mais il y a quelque chose qui m’expulse vers d’autres recherches, vers d’autres contenus qui ne sont pas soutenus en soi dans ces ancrages directs que nous appelons de manière réductrice, comme je l’ai déjà dit, la réalité cubaine. Je parle peut-être d’une circularité sans fin. La réalité peut aussi être une construction de l’œil qui regarde, qui décide de découper, de disséquer les coins d’une ville et de ses habitants ; également les conflits que l’on décide d’avoir (oui, parce que l’on peut aussi décider que l’agriculture, le poulet et le poisson — mon truc c’est les chevaux —, les queues et autres clichés et sous-thèmes qui ont été explorés/mâchés/ruminés par le cinéma cubain, ne sont pas un “vrai conflit” pour vous). Et si le conflit est celui d’une minorité, cela signifie-t-il que le conflit discriminé cesse d’être réalisable, explorable, cinématographiable ?
Il y a quelques jours, j’ai lu une critique du film parue dans Cuba Contemporánea. Le journaliste s’est demandé si, pendant ces années (appelez-les comme vous voulez), les gens ne s’amusaient pas, ne riaient pas, ne faisaient pas la fête, ne buvaient pas, ne dansaient pas et n’aimaient pas. Bien sûr, les gens ont continué à vivre et à être, plus ou moins, ce qu’ils ont choisi d’être. Ma question, Dean Luis, est la suivante : pourquoi devrions-nous comprendre que l’art (surtout les arts de la représentation) doit fonctionner comme un miroir de la réalité ? N’est-ce pas le geste le plus anti-politique de tous, le plus suspect ? Dans une pièce comme L’Opéra de quat’sous, Brecht manie une phrase qui me touche profondément : “si tu montres ta vraie misère, personne ne te croira”. C’est pourquoi je vous assure que Caballos est un film cubain et très cubain, en tout cas aussi cubain que les autres ; politique dans la mesure où les dialogues entre la culture et le pouvoir à Cuba le permettent, même si je ne revendique pas l’attention des micros et des tribunes. Pourquoi ne pas également brandir une devise qui dit : les idées dans le texte sont des sensations. C’est là qu’opèrent les dialogues dont, à mon avis, le cinéma et le théâtre cubains ont besoin. Je ne dis pas que Caballos est la solution. Non. Caballos est ma façon d’analyser cette question, bien sûr. L’ennui, le manque de temps et le manque de foi n’habitent pas seulement certains films produits ces dernières années ; une liste encore plus longue blesse le cœur des gens. Il en va de même pour la teuf, l’impudence et ceux qui font le tapin. Prétendre parler du Tout peut transformer nos films en une sorte d’encyclopédie-Encarta, et les critiques et journalistes en une sorte d’herméneutes du vide.
Savez-vous qu’on me prend toujours pour un Yuma (étranger) dans mon propre pays ? Après tant d’années, cela me fait rire et j’interagis même avec eux ; avant cela m’ennuyait beaucoup et j’argumentais et disais “pinga” avec la même cadence que les belles personnes de Jesús María le disent, mais rien… Je montrais ma carte d’identité ; même cela n’était pas une preuve convaincante. Je viens d’une famille très modeste de parents travailleurs, convaincus que la Révolution a sauvé ce pays, ils me lisaient des histoires russes avant de s’endormir, ma grand-mère me faisait des meringues avec des blancs d’œufs, mes oncles ont migré et se sont rapatriés, nous comptions chaque peso de notre salaire pour joindre les deux bouts. Alors qu’est-ce qui est différent chez moi ? Un jour, j’ai commencé à y penser (mon “étrangeté”) et je me suis dit : “C’est bien que je sois un étranger devant mes compatriotes ! Cela fait partie de mon astralité et je porte cette étoile : mon étoile m’éclaire et me tue. Après avoir été dans d’autres villes (où l’on me considère justement comme un étranger), je vous dis que seule La Havane continue de m’étonner et c’est merveilleux qu’elle le fasse ; il est bon que lorsque je me retourne pour voir le désastre et le prodige, on me prenne pour un étranger dans mon propre pays, car ce si(g)ne réfracte naturellement non seulement les gigas que je filme, mais aussi les parlements que j’écris. Faire un film comme Caballos ne fait pas de moi un paria du cinéma ; je fais partie de la vague de personnes (heureuses ou tristes) qui habitent les coins de ce pays.
J’aime ce fragment d’Octavio Paz dans Réfutation des miroirs : ” Et tes yeux contemplent ton poème, ou est-ce ton poème qui contemple les visions de tes yeux ?” Avant de nous asseoir avec le monteur, nous avons regardé ensemble Mémoires du sous-développement. Je pense qu’il y a beaucoup de Sergio dans Robi : les préoccupations des deux sont liées ; les stratégies discursives des deux films sont très différentes, à l’exception du fait que Mémoires… est mon film préféré du cinéma cubain, en plus d’être d’une grande beauté et génial. Je pourrais aussi dire, au son de Martí/ Gómez/ Maceo/ Camilo/ Fidel, que j’ai fait un film comme Caballos parce qu’il sort de mon entrejambe. Dans ce pays, les têtes proches de la terre sont plus puissantes que les têtes proches du ciel.
Dans Caballos, les échos de vies de poésie résonnent : Martí, Rimbaud, Verónica Voss-Fasbinder… Votre film est-il une recherche de la beauté dans la décadence, du lyrisme dans la défaite ?
Je pense que Caballos parle du désir d’un avenir. En tout cas, la décadence et la défaite d’un avenir qui n’existe pas encore, mais qui bat au loin d’une manière prometteuse. C’est là que je veux explorer, c’est là que se trouvent mon malaise et ma fête, c’est là que je pose mon regard. Je me débats avec le probable — que du bon ! —, presque jamais avec le possible de cette réalité vérifiable qui, parce qu’elle est vécue, m’ennuie beaucoup. Comme si j’écrivais pour un spectateur anachronique de 2080, incorporé dans la compréhension du spectateur d’aujourd’hui. Si, en outre, elle porte les échos que vous dites, alors je suis heureux de les prendre en compte.
Je pense qu’il y a un grand besoin de savoir comment se déroule chaque projet d’œuvre indépendante cubaine, car dans chaque cas il manque des voies rapides et un modèle à suivre. Pourriez-vous, dans une brève synthèse (ou longuement, mais c’est à vous de décider), commenter l’itinéraire critique de production de Caballos?
Désolé, je ne veux pas répondre complètement à cette question, elle contient une chambre hyperbare et des masques à oxygène. La question de la production, qui est absolument essentielle, a la particularité d’être absolument fastidieuse, ennuyeuse. La seule façon de faire un film indépendant à Cuba, je veux dire vraiment indépendant, c’est de se lancer. Comme vous le dites à juste titre, il n’y a pas de moyens, il n’y a pas de modèles, chaque projet exige une façon particulière d’être produit. Il n’y a pas de fonds, pas de lois, pas de sociétés de production indépendantes. Même la persévérance et même la foi ne suffisent pas ; il y a des coups de chance, des erreurs qui mènent à des succès, des rivières qui coulent jusqu’à la mer. Avec le recul, après quatre ans, je sais que cela a été très difficile. De l’extrême. Par moments, j’avais l’impression de pousser une montagne. Mon esprit, dans le seul but de se protéger, efface ces “agressions” et tente de créer des trous noirs qui peuvent être remplis de nouvelles stratégies pour le prochain projet.
Dans votre présentation de Caballos il y a quelque temps, vous avez dit que le film a l’intention de parler de Cuba. Quel est le Cuba dont vous voulez parler ? Quel type de cinéma préférez-vous pour commenter cette condition nationale ?
Que se passe-t-il lorsque vous écrivez une œuvre sur la réalité ?
Je peux vous assurer que cette question est ma plus grande préoccupation ; si elle a une réponse positive, ce que je ne pense pas. On ne peut pas écrire sur la réalité, c’est l’impossibilité de l’Art. La documentation, l’essai, c’est autre chose. Mais l’art, subjectif et manipulateur, ne peut (je dirais même plus, ne doit pas) essayer d’écrire sur la réalité. C’est impossible, c’est un mensonge, elle n’atteint pas sa propre matière. La réalité selon qui ? Selon le cinéaste, selon le dramaturge, selon le peintre ? Et qui est cette personne pour authentifier Mme Réalité ? La réalité (terme excessivement raréfié, soit dit en passant) existe indépendamment du regard artistique et de toute pratique qui en découle. Elle existe même SANS le regard artistique. Je ne sais pas à quel moment est née cette obsession cynique de “penser au spectateur”. Non, monsieur. Le spectateur n’a besoin de personne pour penser à lui, et encore moins pour lui. L’art, soyons encore plus sévères, est une foi morte. Il ne s’agit pas de Paix ou de Guerre. Si vous voulez avoir une expérience de vie, vous devez aller à une fête, vous serrer et transpirer avec vos compatriotes, monter dans un bus bondé, regarder l’immense mer depuis le Malecón. Je dirais que ce sont des expériences vivantes, elles sont là et elles palpitent. Mais nous, cinéastes, aimons trop les avant-premières et les tapis rouges, les flashs et la fausse modestie. À partir du moment où vous placez une caméra devant cette réalité, quelque chose est mis en sourdine, perturbé et s’échappe. Pourquoi sommes-nous, nous les “artistes”, si prétentieux, si vaniteux en pensant que nos pratiques artistiques révèlent des choses profondes sur la réalité ? La vraie douleur de la mort ne sera jamais comparable au simulacre de mort.
Dans mes films, dans mes œuvres, je parle du Cuba que je connais. Un Cuba biaisé, incomplet, des fragments d’une île. Toujours de manière personnelle, la seule manière possible. La vision est limitée aux expériences que nous avons vécues, aux endroits d’où nous venons, à la famille que nous avons eue et à l’éducation que nous avons reçue. Même l’expérience d’une équipe (dans le cas d’une création collective, ce qui n’est presque jamais le cas au cinéma) ne peut traduire une réalité, une société et ses complexités. Le cinéma, le plus trompeur et le plus menteur de tous les arts, ne pourra JAMAIS parler de la réalité ; le jour où quelqu’un trouvera un moyen, tous les écrans du monde brûleront. Les films répètent, discutent, veulent parler d’une réalité inventée. Leur mission est de faire semblant d’en parler (l’invention) et de créer un effet sur l’autre partie. Soyons conscients qu’il ne s’agira que d’une construction pure et dure, d’une proposition sur… Il y a des films plus obliques que d’autres, certains ont l’air plus obliques que d’autres. Mais toutes sont obliques, toutes sont biaisées.
La politique et la philosophie existent grâce à la réalité. La religion et l’art s’appuient sur la réalité. Pour développer cette idée, pour laquelle je ne suis pas du tout préparé, il faudrait un livre. Et ni vous ni moi ne voulons ennuyer les lecteurs.
Il semble que les films choisissent le cinéaste et non l’inverse. Je voudrais que chaque film que je fais, chaque pièce de théâtre ou chaque poème que j’écris, ne ressemble en rien à celui qui l’a précédé. Quelque chose comme écrire contre ma voix ; ou plutôt, contre le style. Ce que nous appelons style est la mort du cinéaste, de l’écrivain. Le style est la formulation d’une praxis : l’extinction des découvertes. Je voudrais toujours parler de Cuba, de cette condition nationale, d’une manière totalement et absolument inconnue. Comme un étranger ébloui par ce qu’il voit. Une voie inventée au cours du processus qui vous a choisi, même si elle implique une réflexion profonde chaque fois que vous êtes confronté à un nouveau projet. Je voudrais parler de Cuba et de cette condition nationale, que je perçois à peine, depuis des endroits qui ne me sont pas confortables ou familiers. De moi, bien sûr ; moi différent de toi, toi différent de moi. Prendre conscience de nos individualités est ce qui favorise l’émergence de halos collectifs.

Le choix du traitement plastique et de la performance scénique des acteurs indique la présence d’idées provenant de la photogénie classique du cinéma. Avez-vous suivi ce critère dans la construction mélancolique et languissante de la mise-en-scène ?
J’ai beaucoup travaillé avec le directeur de la photographie Javier Labrador, nous avons vu beaucoup de photos de Mapplethorpe, nous avons proposé une mise en scène qui combinait la nature statique de certains plans avec des moments de “flottement” de la caméra portée à la main. Nous savions depuis le début que ce serait en noir et blanc. Nous avons travaillé avec la caméra Black Magic, répété avec les acteurs sur place, ajusté le scénario technique après les tests de caméra. Pendant deux mois, j’ai travaillé avec les acteurs, chaque jour, nous avons fait passer le scénario comme une pièce de théâtre sous l’œil attentif de Carlos Díaz, qui m’a aidé à les placer dans le ton que je recherchais. Ils savaient quelle valeur de plan ils allaient avoir pour chaque discours, où ils regardaient, pourquoi. Il n’y avait pas de place pour une quelconque improvisation. Nous avions très peu d’argent. Nous avons été très efficaces pendant le tournage, environs 30 minutes ont été mis au chutier dans la salle de montage, conformément au scénario.
J’ai aussi beaucoup travaillé avec Taimí Ocampo, qui était la directrice artistique. Nous avons pris des décisions communes entre la photographie et l’art. Les performances des acteurs ne pouvaient pas être libres, elles étaient limitées, le défi était de les intégrer dans cette dynamique. Quand je le regarde, on dirait que le film a été réalisé avec beaucoup de temps, de café et de cigares entre les scènes. Et la vérité est que nous avons tourné avec beaucoup d’urgence, à cause du budget. Des plans composites ont été utilisés, changeant les valeurs de plans dans la même image, souvent frontale. La lumière et le dessin des profils étaient importants. Je pense que la photographie et la direction d’artistique ont un grand impact visuel sur le film, et je suis heureux d’avoir travaillé avec.
La photographie en noir et blanc suggère à nouveau l’hommage à Mapplethorpe. Mais il me semble qu’il y a quelque chose de plus : essayiez-vous de renforcer un sens de la réalité en dehors du temps et de toute coordonnée géographique spécifique ?
Bien sûr qu’il y en a. Il y a plus qu’une simple tentative de transférer le noir et blanc contrasté des photographies de Mapplethorpe à Caballos et d’établir ainsi tacitement l’hommage, la rencontre. Le noir et blanc m’a également permis d’homogénéiser la proposition stylistique, de mettre en avant l'”artifice” du film : la photographie, l’art, même la musique, qui a été composée par un musicien aussi spécial que Roberto Fonseca. Entrer dans ces espaces, dans leurs décors, avec ces effets sonores de vent, si marqués, presque mélodieux… ils avaient le désir et le but de nous inviter à entrer dans cette Havane oblique dont vous avez déjà parlé, le monde particulier (étrange ?) de ces personnages qui parlent de manière si imposée et même fausse, avec ces rituels aussi tranchants que le punch que prépare Salomón, avec leurs manies. J’ai pensé que tous les éléments de la mise en scène devaient être élargis. Ils ont été augmentés à partir du montage. C’est sur l’île de montage que le rédacteur Juan Manuel Gamazo et moi avons pensé qu’il serait bon de renforcer cette “sensation de réalité hors du temps”. Le scénario comprenait déjà des images d’archives, la chanson “El mambí” de Julio Casas Romero, la division externe en prologue, première partie et deuxième partie (l’épilogue a été inventé lors du montage). Puis, à cette première et deuxième partie, j’ai ajouté l’annotation : respectivement fin décembre et début janvier. Comme si le film voulait faire un saut dans le temps, du triomphe de la Révolution à aujourd’hui ; comme si l’on commentait que nos réalités (celle de 1959 et celle de 2015) étaient toujours les mêmes réalités indissolubles. Ensuite, la fragmentation des histoires, la dislocation des personnages et de leurs désirs diffus, qui se disjoignent tout au long du film, chacun suivant les chemins qu’il a décidé d’emprunter, permet aussi de comprendre le sentiment de solitude qui les hante, la mélancolie qui plane sur ce Cuba de Caballos.

Je m’attarde sur le geste brechtien du proème et de l’épilogue. Mais surtout dans le proème, qui est une provocation tacite : pensez-vous qu’il soit nécessaire d’élever la “complexité” de l’œuvre d’art, pour éviter qu’un cheval ne soit que ce que la populace confond avec un morceau de viande ? Ce choix de la “complexité” ne condamne-t-il pas Caballos à ne pas se connecter avec la majorité du public, qui ne pourra pas accéder à ses clés décisives ?
Avec ce proème ou prologue, quel que soit le nom qu’on lui donne – c’est bien que tu cites Brecht –, je cherchais un effet contraire à cette sorte de captatio benevolantiae, une invitation métaphorique, une énigme, au seuil d’entrée du film. En d’autres termes, je voulais écrire un anti-prologue. En d’autres termes, je voulais écrire contre moi-même. Je voulais recréer cette partie du cinéma cubain (drôle, comique, vernaculaire ; le ton et les dialogues du prologue sont différents) qui ne m’intéresse pas du tout et qui me provoque une certaine éruption cutanée. Cependant, ce prologue contient quelques indices “nécessaires” pour pouvoir lire le film dans son intégralité. C’est un peu Daniel Díaz Torres, un peu Gerardo Chijona, un peu Guantanamera ; sans arriver à la hauteur de ces maîtres. J’ai grandi en regardant leurs films ; aujourd’hui, ma praxis les annule. J’espère qu’avec moi, s’il vous plaît, tout enfant insolent fera de même. Oui. C’est une provocation, comme vous dites, qui finit par me mordre moi-même, car on fait partie (consciemment ou non) de la chaîne qui vous entoure : la toile d’araignée du cinéma cubain. Mais un morceau de viande peut aussi être un cheval décomposé : avec son médaillon et son pedigree ; le Potemkine qui nous invite à prendre les armes contre ce que nous n’aimons pas, que ce soit des films ou des patates douces. C’est une foule alertée, prévenue, en garde contre les épidémies du cinéma national et du quartier infecté ; enveloppée dans la fumée grise de leurs motofumigators, la fumée des canons Mambise et des AKM soviétiques.
Les drames (les dramones) ne sont plus des drames de personnages agissant qui peuvent être motivés psychologiquement, socialement ou selon tout autre critère de vraisemblance. Cette recherche d’un espace esthétique et social commun, loin des grandes contradictions ou des conflits de l’histoire, implique réellement un lien étroit avec la tradition et le patrimoine, non seulement avec le patrimoine culturel (les grands auteurs, les grands textes classiques, les mythes fondateurs de la vie symbolique et sociale), mais aussi avec le patrimoine des pratiques artistiques. Si c’est ce que vous entendez par “complexité”, alors je dois vivre pour être un exhausteur de cette complexité.
D’autre part, je dois préciser que la “complexité” n’est pas un choix a priori, elle ne l’est jamais dans mon cas. Je ne planifie pas mes projets en tenant compte de la somme des complexités qu’ils peuvent accueillir, car bien souvent, ces décisions peuvent aboutir à l’obscurité, à des obstacles, à la bride d’un cheval. Caballos est le produit de ce que je suis, de mon (dés) apprentissage et de mes choix artistiques et émotionnels. Bien sûr, ces choix révèlent une position politique : une badinerie formelle. Je ne peux pas être autre chose que ce que je suis. Ce n’est pas une pose : l’écorce de l’artiste complexe et tourmenté. Non. C’est ainsi que les choses se sont passées pour moi et j’écoute leurs battements et leurs miettes de pain sur le chemin de l’intuition et des confirmations.
Vous, qui êtes un homme intelligent, l’avez déjà dit carrément. Toute explication de ma part serait un coup de pied incessant au milieu d’une piscine profonde, très profonde, qui finira inévitablement par m’engloutir. Je suis conscient du film que j’ai écrit, du film que j’ai tourné et de l’autre film que nous pourrons voir sur grand écran. Chaque film a son public et dans Caballos, ce n’est pas différent. Ce qui apparaît est le produit d’une vérité personnelle, une vérité qui me satisfait. Comme je vous l’ai dit, il m’est impossible de penser au public. Je préfère penser à “El Público” de Carlos Díaz. Je pense qu’il est de mon devoir de ne pas penser à ce public car je pourrais finir par être comme ces personnes qui veulent paraître bien aux yeux de tous et qui finissent par se détester. Contre le cynisme. En faveur de la pudeur que l’on laisse transparaître en montrant ses “vérités” (ce qui ne compte que pour soi ?).
La “complexité” est une variable qui dépend de l’œil qui regarde, de l’oreille qui écoute, du cerveau qui pense. Qualifier Caballos de “complexe” fait partie de l’évaluation des œuvres, par rapport au public moyen que l’on imagine fréquenter nos cinémas ; ces mêmes personnes avec lesquelles nous partageons au jour le jour ce que nous appelons la réalité. Ne pensez-vous pas ? Je préfère lire Caballos comme une simple histoire d’amour. Non pas parce qu’elle est simple, réaliste ; encore moins, ancrée dans une réalité asphyxiante et vérifiable.
Que pouvez-vous nous dire à propos d’ Aristóteles Moore, votre nouveau scénario ? De quoi parle-t-il ? Comment se déroule sa production ?
Aristóteles Moore est né dans le cadre de mes discussions avec Eliseo Altunaga alors que je rédigeais mon mémoire de fin d’études à l’EICTV. Les scénaristes doivent écrire un long métrage et Eliseo était mon tuteur. Il s’avère qu’Eliseo voulait à tout prix que je change le personnage principal (j’avais un personnage secondaire qu’il préférait et il insistait jusqu’à me faire la guerre, hahaha), mais je ne voulais pas prendre cette décision, car ce n’était pas l’histoire que je voulais raconter. Le professeur m’a tellement harcelé et j’étais si tête de mule, que je n’ai jamais changé le personnage principal… mais quand j’ai quitté l’école, j’ai écrit Aristóteles Moore, avec ce personnage secondaire qu’il aimait bien comme personnage principal. Juste le personnage, à peine une esquisse. Parce que le cadre est différent, tout comme l’histoire qui l’entoure. Elle a été imaginée pour Juan Miguel Más, qui a travaillé sur mes courts métrages et apparaît dans les scènes de bar de Caballos. C’est un grand ami que j’admire beaucoup, que j’appelle affectueusement “mon acteur fétiche” (j’ai réalisé le court-métrage de trois minutes avec lui en première année d’école en 2011 et depuis, j’essaie toujours de l’avoir dans mes projets, comme s’il était un avatar d’Elegguá qui m’ouvre la voie).
Quelques jours avant de quitter l’EICTV, j’ai écrit un court synopsis que j’ai remis à Mauricio Escobar (Guatemala), avec qui j’avais réalisé Kendo Monogatari et où travaillent Verónica Díaz, Juan Miguel et Edith Massola. Nous avions obtenu de très bons résultats avec ce court métrage, nous avons reçu une mention spéciale du jury à Clermont-Ferrand, le court métrage a été présenté dans 30 festivals. J’ai écrit le scénario et l’année dernière, nous avons gagné le prix IBERMEDIA pour le développement. Nous en sommes juste à cette étape du projet : montage des dossiers et traduction, nous avons un budget adapté, nous recherchons des coproducteurs et complétons un éventuel casting pour nous lancer à la recherche de l’argent avec lequel nous pourrons le tourner fin 2016. Du moins, provisoirement. Le scénario a été finaliste du concours de scénarios du Festival du film de La Havane et est ensuite passé par les bureaux d’études du secteur de l’industrie.
Un bref scénario pourrait être le suivant : “ Aristóteles Moore est un homme obèse qui veut perdre du poids. Ses illusions augmentent lorsqu’il tombe amoureux de Tim, un agent de sécurité de la première usine McDonalds à Cuba. Mais Aristote Moore va découvrir douloureusement que l’amour et les hamburgers sont des chemins divergents dans sa vie”.
Articles similaires
Partagez cet article