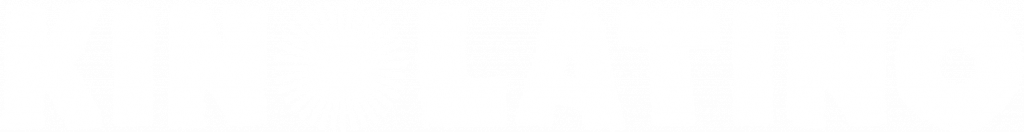Le film documentaire “Guañuna” enquête sur le meurtre de Paúl Guañuna, un étudiant de 16 ans, un crime commis par des agents de la police nationale à Quito en 2007. David Lasso a travaillé sur ce film pendant 15 ans et c’est son premier long métrage.
Par Jorge Flores V.
Pourquoi avez-vous décidé de commencer cette enquête, quel est le point de départ ?
Le point de départ est que j’ai une amitié avec ma collègue Paulina Ponce, quand cela s’est produit, puis j’ai vu cette affaire à la télévision, aux actualités. Ça m’a choqué parce que cela c’est passé dans l’école où j’ai étudié (Colegio Central Técnico). C’est ma collègue qui a accueilli Don Leonardo, le père de Paúl, lorsqu’il est arrivé au CEDU le lundi, c’était le 8 janvier, quand il est arrivé il était dévasté ; et elle s’est occupée de lui. Elle m’a donc raconté, j’ai vu les nouvelles, et là, c’est ce que je raconte dans le film, vient le besoin d’exprimer que cela ne se reproduise plus, surtout parce que nous aussi on a des enfants, et en même temps on a de l’empathie pour cette famille.
Je travaillais dans le domaine des droits humains depuis que j’étais jeune et cette collègue m’a parlé de toutes les choses qui se passaient et c’est alors qu’elle m’a présenté. C’est à ce moment-là que j’ai commencé à filmer le procès, un an depuis que l’affaire était en cours. Il y avait beaucoup de matériel d’archives que d’autres activistes vidéo avaient réalisés, maintenant il est très normal que tout le monde filme, mais il y a 15 ans il était plus difficile d’avoir une caméra VHS ou Hi8. De nombreux activistes vidéo ont enregistré des images et j’ai pu les compiler, et en cours de route, j’ai pu voir qui d’autre était dans la même empathie et on a uni les forces.

Combien de temps ont duré les recherches, le tournage et la post-production ?
Bien sûr. Ici, je dois dire que ce fut un processus très complexe pour moi sur le plan personnel et professionnel ; ce sont deux scénarios que je ressens comme différents et qui ont provoqué beaucoup de complexité chez moi. Professionnellement, parce que c’était mon premier long métrage ; j’ai réalisé de nombreux courts métrages documentaires auparavant, j’ai réalisé un moyen métrage. J’ai fait tout cela avec très peu de ressources et je suis moi-même, dans cette mouvance de tout devoir faire seul, à cause du manque des ressources.
Ainsi, dans ce projet plus long, il a exigé de moi une croissance impressionnante. Je vous parle de l’écriture de scénario parce que, finalement, dans l’audiovisuel, on écrit souvent des scénarios en tournant, on écrit des scénarios en montant, c’est là que le scénario s’écrit. Je suis monteur. J’ai commencé en tant que monteur. Je me sens très à l’aise en tant que monteur, donc j’ai réglé toutes les choses en les montant.
Alors maintenant, essayer de faire un processus complet a exigé une croissance de ma part, une exigence très complexe pour moi. Une autre complication était la durée, j’avais au départ une version de 4 heures, donc c’était très complexe. Cependant, je pense que cela en valait la peine. Ce furent environ 15 ans de tournage environs. C’est bien plus que ce que j’aurais voulu dépenser, et j’étais très impatient. Cependant, il y a eu comme un temps où je devais le faire. Je ne me vois pas le faire en moins de temps car il y avait aussi le facteur personnel. Et pendant que l’on apprend la question cinématographique, on s’associe à d’autres personnes.
Pour moi personnellement, la question la plus humaine et la plus personnelle est celle qui m’a donné le plus de complications. J’ai commencé à le faire quand j’avais plus ou moins 30 ans, donc j’ai commencé à le faire avec une sorte d’énergie, et je sens que la question de la justice, la question de la mort, la question de la prison, de la douleur ; toutes ces questions m’ont traversé pendant ces 15 ans. C’était donc très complexe humainement d’affronter la mort, d’affronter la prison, la justice, la vérité, dans la chair. Il s’agissait donc non seulement de le voir de l’extérieur en tant que monteur et réalisateur, mais aussi d’essayer de l’assumer de l’intérieur, et c’est pourquoi j’avais de nombreuses contradictions internes. Je pense donc que c’est ce qui m’a pris le plus de temps, essayer de comprendre la justice dont je veux parler, ou d’où je veux parler de la justice.
Il est également intéressant de voir comment le sens est créé par la narration cinématographique, par exemple avec le thème de la justice. Vous en avez parlé comme des difficultés que vous avez rencontrées dans ce projet. Dans ce sens, il serait intéressant que vous nous parliez davantage des difficultés que vous avez rencontrées vers la fin du projet, qui, je pense, sont liées à la question de la justice.
Oui, c’est un sujet un peu complexe pour moi, peut-être que je ne sais pas si on le ressent dans le film, mais nous allons chercher les certitudes. La certitude serait la question de la dénonciation, la question de dire “trop c’est trop”, qu’il y a un cas de meurtre, une violation des droits de l’homme et qu’il doit être dénoncé, il doit être affronté avec courage, avec force et de front. Je pense que cette certitude a été présente tout d’abord parce que je viens d’une école publique. La question de la confrontation avec la police a été présente depuis que j’ai 11 ou 12 ans, à l’école, je me souviens des confrontations avec la police, le sang, les blessés, la peur. C’est beaucoup de choses que vous vivez dans une école publique et puis que vous sortez dans la foule, où je n’ai pas jeté que des pierres. Je pense que j’ai jeté une pierre, mais en tant que curieux, j’étais là, comme tous les centaines d’adolescents curieux qui sont là, et qui essaient de se battre avec quelqu’un et de décharger toute leur colère et, pire encore, ce quelqu’un vous maltraite…
Donc, je pense que c’est là que se situe la question de la dénonciation, de dire “qu’est-ce qui se passe avec les jeunes des secteurs populaires ?”, on a déjà normalisé le fait de leur tirer des balles, de leur lancer des bombes lacrymo, de leur donner des coups de bâtons, de les gazer, tout-çà c’est déjà normal ; c’est-à-dire que les jeunes sortent pour manifester et c’est normal que la police les tabasse.
Je pense que cela a été une certitude ; cependant la justice est la question que je voulais aborder, et c’est peut-être là que cela m’a pris beaucoup de temps, à savoir si la prison résout la punition. Du point de vue des droits de l’homme, je suis abolitionniste, donc je ne crois pas à la prison, en fait, je crois que la prison elle-même n’est qu’un rouage de plus dans un système d’injustice car elle est créée avant tout pour les secteurs populaires. Comment faire un film qui réclame justice, mais qui en même temps remet en question le type de justice que nous essayons d’affronter. C’est pourquoi j’ai essayé de trouver un équilibre, un niveau, un point de vue, pour ne pas me laisser emporter et tomber dans un pamphlet. J’ai donc beaucoup lu, j’ai aussi beaucoup interviewé, et surtout, pour voir comment ne pas diaboliser un secteur, mais plutôt pour essayer de dire “ceci est arrivé, ceci n’aurait pas dû arriver et ceci ne devrait pas continuer à arriver”. Et en même temps nous devons punir sans aucun doute, mais nous devons générer, je mets quatre mots à la fin : “vérité”, “justice”, “réparation” et “non-répétition”, dans l’intention d’y réfléchir de manière plus globale ; non pas pour dire qu’ils doivent pourrir en prison, mais pour dire “voyons, cela nécessite beaucoup plus d’aspects dès le départ”.
Et, pour moi, ce qui m’a beaucoup aidé, c’est que pendant cette période, je me suis approché de la philosophie bouddhiste, et à partir de là, cela a été un moyen pour moi d’essayer de comprendre, comment faire un document qui ne génère pas de haine, mais de la réflexion. Je ne sais pas si j’ai vraiment atteint cet objectif, mais c’est ce qui m’a motivé et pourquoi j’ai attendu tout ce temps. Parce que finalement, les derniers plans que j’ai filmés ont été pris il y a plusieurs années, c’est-à-dire que j’aurais pu le monter il y a plusieurs années, mais au moins dans mon cœur, j’ai dû mûrir un peu pour ne pas le faire à partir du ressentiment, et ne pas faire un film à partir de la colère, ou de la douleur, mais plutôt, pour essayer de mettre les choses en équilibre ; parce que ça ne m’intéresse pas de générer plus de haine ou de douleur chez qui que ce soit ; mais évidemment, il faut arrêter, dénoncer, et surtout demander des changements et réaliser ce changement. Je ne sais pas si j’ai une fois de plus répondu à la question.

En vous écoutant, une autre question me vient à l’esprit, à savoir : quelles sont vos attentes vis-à-vis du public ? Parce que nous parlons d’un film important pour la communauté de Zámbiza, de Quito et pour tout l’Équateur en fait, où le festival EDOC montre ce type de film de dénonciation, en provenance de nombreux pays du monde, depuis plus de 20 ans. Quelles sont vos attentes quant aux débats qu’il pourrait susciter dans la société ?
Eh bien, bien sûr, ce qui me rend nerveux, c’est que c’est mon premier long métrage, de le présenter en première comme ça, même si j’ai déjà projeté plusieurs œuvres ; mais c’est une question très intime, enfin, pas intime, mais très profonde de mon être. Les autres choses que j’ai faites, c’est beaucoup de militantisme, beaucoup de confrontation depuis une position à gauche, pour ainsi dire, mais maintenant je sens que j’ai voulu prendre un peu de distance par rapport à cette place de confrontation entre les bons et les méchants, les bourreaux et les victimes, et essayer de voir les choses d’un autre côté. Peut-être que ce que je voudrais aussi vous dire, et par rapport à la première question, j’ai fait ce film parce que j’ai ressenti de l’empathie pour ce cas, je me suis vu reflété dans un père qui pleurait la mort de son fils, et j’ai eu un fils, maintenant il a grandi, donc cette empathie m’a conquis.
Mais il y a autre chose, je voulais faire le portrait de mon école. Pour moi, l’adolescence a été très intéressante à l’école, au Central Técnico ; j’ai beaucoup apprécié en général, socialement, ce que l’on y vit. Et ce que je voulais, c’était faire un document pour les jeunes des secteurs populaires. Je ne sais pas si j’ai réussi ; cependant, le film est ce qu’il doit être. Puis je me suis laissé aller là où le film m’emmenait, mais je voulais dialoguer avec les jeunes du Central Técnico, ou avec les jeunes de Mejía, Montufar, Montalvo, avec n’importe quel jeune d’une école publique de la classe ouvrière ou des quartiers populaires où j’ai aussi grandi, et qui ont cette confrontation de classe, une confrontation économique, une confrontation de pouvoir avec l’autorité et avec la discipline, donc j’aimerais que ce film y travaille, pourquoi ? Parce que les “chapas” (les flics) viennent aussi des secteurs populaires, les “chapas” viennent des écoles publiques ; autrement dit, les “chapas de tropa” viennent de là. Donc, je voulais leur parler, en bref, aux futurs “chapas”, et aux jeunes rappeurs, et avec eux je voudrais prolonger une idée qui est soulevée dans le film et qui est de dire, il faut réfléchir à tout ça.
Le policier est une introspection dans une société disciplinaire où nous agissons tous de manière disciplinaire selon le rôle que nous avons, et certains plus que d’autres évidemment, parce que certains ont l’usage légitime de la force. Ce sont tous des acteurs sociaux qui ont un impact, donc je ne pense pas que le festival EDOC atteindra les jeunes des écoles publiques du sud de Quito, mais je voudrais qu’ils les atteignent évidemment et c’est pourquoi ma stratégie de distribution sera là. Cependant, je suppose que le public d’EDOC est également composé de gestionnaires et de décideurs culturels ; ce sont des personnes qui ont une relation avec la politique ; et essayer de comprendre la relation qu’ils ont, ou le rôle, ou la situation que les jeunes des secteurs populaires traversent ou vivent me semble très important de le mettre sur la table. Que tous les acteurs sociaux forment finalement une grande famille en tant que société et que nous devons donc nous regarder les uns les autres y compris les jeunes des zones rurales ?
C’est pourquoi je serais intéressé de voir que dans EDOC il y ait une sorte d’empathie pour essayer de penser à ce qui se passe dans ces endroits et à cette époque, le temps des générations, mais aussi de certaines heures, des jeunes la nuit qui traînent en groupes ; j’étais l’un d’entre eux, qui traînaient dans les rues du sud de Quito en buvant et bien sûr, maintenant ça ne se fait plus de la même manière. Aujourd’hui, je pense que les temps sont beaucoup plus complexes et c’est pourquoi le film tente d’apporter un peu de lumière, de dire “n’essayons pas de tout diviser de manière catégorique”. Je ne sais pas si je vais dans cette direction.

Dans le festival EDOC, il y avait un programme dans lequel les écoles venaient dans les salles de cinéma, je ne sais pas s’il existe encore. Le festival a connu quelques revers et de nombreuses activités positives ont dû être reportées en raison du manque de budget. Je suis d’accord avec vous sur l’analyse du public qui se rend aux EDOC, parmi beaucoup d’autres, il y a aussi des personnes qui prennent des décisions, qui sont dans la politique, dans le secteur public, dans le monde universitaire, qui peuvent porter ce débat sur la vérité et la justice dans d’autres espaces ; ce qui peut être très enrichissant et je suis sûr qu’il le sera, en raison de l’importance de la dénonciation que Guañuna montre.
En ce sens, il est intéressant de parler de votre relation avec Leonardo. Comment marquer une distance dans un sujet aussi émouvant, qui éveille tant d’empathie, comme vous le mentionnez, qui indigne aussi et peut vous conduire, en tant que cinéaste, à la dépression ? Quelle a été votre relation avec le père de Paul, avec ce père courageux qui perd son fils, et quelles limites avez-vous posées à cette relation ? Comment avez-vous décidé de le filmer ?
Eh bien, je pense que la relation avec Don Leonardo a changé avec le temps. Cela fait environ 13 ans qu’on se connait et je dirais qu’il y a trois étapes qui sont très différentes. L’une est l’histoire qui est racontée dans le récit filmique, et l’autre est l’histoire que l’on vit dans la réalité, l’histoire qui se passe. Le fait que l’on essaie de faire ce portrait, la réalité, d’un seul point de vue, ne signifie pas qu’il existe de multiples façons d’exister cette réalité.
Je dis ça parce que, par exemple, maintenant que je m’en souviens, une fois que je tournais Don Leonardo, et c’est une scène qui n’a pas été retenue à la fin, c’était une scène que je pensais allait s’y trouver d’office et qui a fini par être éliminée. J’ai filmé Don Leonardo pendant 40 minutes, il explosait en larmes, et j’ai éteint la caméra. J’éteignais la caméra, tout ce que je voulais c’était le serrer dans mes bras, et je posais la caméra en me disant, qu’est-ce que je fais, est-ce que je continue à filmer, est-ce que j’arrête ? Et puis j’ai continué à enregistrer, et c’était un moment très difficile. Cependant, ces 40 minutes filmées n’ont pas été retenues à cause du montage, le personnage filmique se construit aussi.
J’ai donc l’impression que Don Leonardo, lorsque je l’ai rencontré, était dans les audiences qui sont dans le film et puis c’était comme maintenant. En d’autres termes, ce qui se passe avec le cas de Belén Bernal. Il y a un désir d’aller soutenir physiquement et de dire que nous voulons tous la vérité, encore plus la famille, mais nous tous, c’est-à-dire en tant que société, nous voulons aussi la vérité.
Donc, je pense que, malheureusement, c’est un état permanent de la police. Ce n’est pas le moment, c’est chaque année. Vous pourriez faire une chronologie. Toutes ces années, toutes ces affaires, les films que l’on pourrait faire sur la police, c’est absurde, mais c’est comme ça. Donc, je pense qu’à ce moment-là, c’était un moment de bataille avec Don Leonardo, pas seulement le mien, mais celui de beaucoup d’activistes ou d’activistes vidéo. Il y a beaucoup d’images qui apparaissent et qui ne sont pas filmées par moi, mais ce sont des gens qui essayaient de soutenir avec une caméra, parce que c’est ce qu’ils pouvaient faire.
Donc, à ce moment-là, c’était ma façon d’être là ; et c’était çà la relation, en tant qu’un, en tant qu’un autre allié, essayant de rechercher la vérité et la justice. Après que les procès aient commencé à se terminer et que tout ait commencé à stagner, le temps est venu de monter, et c’était un temps d’amitié, peut-être, avec Don Leonardo, que j’allais le voir, je lui disais comment ça se passait, nous partagions des choses. J’ai enregistré beaucoup de choses là-bas à Zámbiza et j’ai appris à le connaître un peu mieux. Maintenant, il est un peu plus distant ; j’essaie aussi d’être très respectueux, si pour le reste de la société c’est un cas, pour la famille ce n’est pas un cas, c’est un fils, c’est un frère. Il y a donc certaines blessures qui ne sont pas guéries et beaucoup d’entre elles ne veulent pas être revues.
C’était donc aussi ma façon d’essayer de trouver une forme dans le montage, pour que les blessures de la famille ne reviennent pas. Même si c’est impossible, ne pas le faire. Cependant, j’ai l’impression que maintenant, c’est une époque différente avec Don Leonardo, et bien, chacun a sa propre façon de faire son deuil d’une manière différente. Cela a été un thème pour moi aussi, de réfléchir à la façon de gérer la douleur ; et comme je vous le disais, beaucoup de ces thèmes qui sont dans le film me sont arrivés aussi. C’était donc comme si je ne le voyais pas à l’écran dans la ligne de montage, mais dans ma propre vie, pour voir ce qui se passe, avec cette douleur.
Et donc ce film est construit à partir de la colère initiale, de la dénonciation, de la douleur et aussi en essayant d’avoir une sorte d’équanimité à partir de laquelle regarder l’événement, le raconter avec force. L’équanimité ne signifie pas la passivité, mais plutôt le contrôle des impulsions. C’est aussi la relation avec Don Leonardo, à différentes époques.
Actuellement, il y a une situation médiatique et sociale qui remet en question le travail de la police nationale, je fais référence au cas de l’avocate María Belen Bernal (disparue dans l’école supérieure de la police et son cadavre fut retrouvé dans les environs). Étant donné que vous êtes un connaisseur de ce type de questions, quelle est votre opinion par rapport à cette affaire ?
Je n’ai pas parlé de cette situation en relation avec le film. Peut-être, afin de ne pas essayer de profiter de la situation, pour ainsi dire. Malheureusement pour une institution qui a beaucoup de choses à changer, il s’agira toujours d’une situation de dénonciation des droits humains.
Parce que ni avant, ni maintenant, ni dans un avenir proche, il n’est probable que cela change beaucoup. En d’autres termes, c’est une institution qui est comme le fil du rasoir : elle est faite pour cela. Et évidemment, le problème est que les secteurs populaires sont à la limite. Donc ils finissent, je ne sais pas si vous avez vu nos photos des gens, des parents, des filles, des fiancées, d’un côté, en train de protester, mais le fiancé, le marié est un policier ; la mère proteste mais le fils est un policier, il est de l’autre côté. C’est donc une société divisée qui s’affronte, et c’est absurde.
Je pense que, pour y revenir, il me semble que la première chose que l’on demande, du moins après avoir suivi cette affaire de près pendant toutes ces années où est la vérité ; et ce que la mère de María Belén demande, c’est la vérité. Elle ne demande pas des excuses initiales ou de démolir un bâtiment, elle demande juste la vérité. La vérité fait donc partie de la justice, qui n’existe pas. Et dans ce cas, un juge a proposé la vérité et un autre juge est venu et a dit “non, ce n’est pas la vérité” ; il me semble donc que ce n’était pas très clair non plus, même avec toute l’enquête que nous avons menée sur le terrain ; il m’a fallu environ deux ans pour parcourir toutes les pages des documents, j’en ai lu environ mille. Impressionnant, en d’autres termes, essayer de faire un chronogramme de la façon dont les événements se sont déroulés, lire tous les documents, c’est quelque chose qui m’a beaucoup épuisé. Ces deux années ont été très difficiles, et d’autres collègues de l’EDOC m’ont également aidé à lire leurs documents car je me perdais un peu. Il était difficile de systématiser toutes ces informations, mais il était un peu difficile d’essayer d’aller chercher toutes les idées et de les condenser sans sentiment mais comme des informations.
Il me semble donc que cette vérité, si c’est la première chose que l’on demande, et ensuite avec cette présomption de vérité pour arriver à la justice, qui doit être une sanction. Mais après cette punition, elle ne doit pas rester une vengeance. “La justice n’est pas la vendetta”, disait-on, mais si ce que nous voulons c’est que quelqu’un pourrisse en prison, on ne trouve pas d’autre moyen que de faire souffrir l’autre. J’ai donc commencé à faire des recherches sur toute cette question criminelle, à lire beaucoup, et à essayer de trouver une alternative pour montrer que la justice n’est pas une vengeance. Le problème est qu’il ne faut pas s’arrêter là, il faut passer de là à l’autre, qui est la réparation. La réparation des familles. Il faut donc penser à la famille maintenant, dans ces cas de féminicides, comment elle va être entièrement réparée. Non seulement sur le plan économique, mais aussi sur le plan politique, émotionnel, psychologique et spirituel, comment effectuer une réparation intégrale. Ce n’est pas seulement une question d’argent, mais sans doute ça passe par là et c’est essentiel.
Et puis, les changements que l’État doit faire et ceux qui doivent être faits, soit dans la société, soit dans l’institution, ou les changements qui doivent être faits pour que ces cas ne se reproduisent plus. Il me semble donc que le film traite peut-être davantage de certaines questions que d’autres, mais j’avais l’intention de remettre en question ces points, en essayant d’en faire une réflexion plus complète.
Articles similaires
Partagez cet article