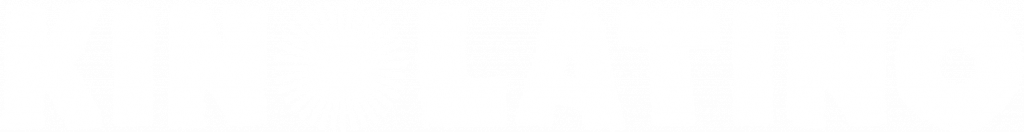Le documentaire “El día que me callé” (Le jour où je me suis tu), de Victor Arregui et coréalisé avec Isabel Dávalos, cinéaste et productrice équatorienne. Le film reconstitue la terrible rencontre entre Arregui lui-même et la violence de l’État équatorien dans les années 1980, alors que le cinéaste était un jeune étudiant et un militant politique.
Par Jorge Flores V.
Comment est née l’idée de ce film, quand vous et Isabel avez décidé de lancer ce projet et pourquoi ?
Victor Arregui : Eh bien, Isabel m’a envoyé une WhatsApp et m’a dit : “Pourquoi ne fais-tu pas un documentaire sur ce qui t’est arrivé ?” Et je n’y ai pas attendu longtemps, tu vois, c’était comme si je me disais que quelqu’un devait s’en charger pour moi, que quelqu’un dans ma vie devait rendre compte de cet aspect, que je trainais depuis que j’étais enfant. Quelqu’un devait aussi allumer l’interrupteur ; et c’est là que ça a commencé, alors je me suis assis, j’ai écrit quelques mini-récits pour chaque séquence, pour chaque événement, et je les ai envoyés à Isabel. Elle l’a vu et m’a dit “Voilà, c’est comme une petite première catharsis” d’approcher, de raconter, de se libérer d’une certaine manière de cet événement. Il n’y a donc pas de raison claire, il y a toujours eu cette question du pourquoi maintenant. Et je ne pense pas qu’il y ait une petite réponse, je pense qu’a un certain moment dans la vie où l’on doit se réveiller du silence. C’est pourquoi je fais ce film, précisément pour qu’il n’y ait pas de silence, pour que nous commencions à parler.
Et je pense aussi que mes enfants sont grands maintenant. Parce que j’étais toujours inquiet de savoir comment, là, j’étais inquiet et puis je me suis inquiété, parce qu’ils sont dans le film, dans de grandes parties du film, et ils ont tous les deux eu peu à faire avec, mais ils ont été impliqués dans cette expérience. Il y avait donc cette question de savoir si c’était un documentaire, si c’était une fiction, puis c’était bien une fiction, puis à nouveau documentaire ; et ce fut hybride, comme un mélange d’une première œuvre de fiction que j’ai aimé d’en faire du documentaire ; avec un scénario, une séquence, on est limité, et puis c’est filmé ; mais ceci, bien sûr, peut avoir cinq cent mille bords, par ici, par là, pendant que vous parlez, l’événement, l’histoire ; et je pense que nous avons réussi à avoir un montage avec tout cela, mais je n’ai pas une sorte de “je veux vous dire maintenant”. Une de mes lectures énonçait l’idée que les silences peuvent durer toute une vie, mais maintenant l’homme a évolué et les gens parlent quand ils doivent parler. Et pour moi, le projet de ce film est que ces choses cessent de se produire, parce que je pense qu’elles se produisent encore, et que nous commencions à en parler.
En écoutant ce que vous dites sur la mise en scène, qui dans ce film a la complexité d’être quelque part entre la fiction et le documentaire, et qu’il y avait de nombreuses façons dont le film pouvait aller, la question se pose de savoir comment vous avez assumé la coréalisation avec Isabel, quel est le processus de réalisation d’un film entre deux personnes ? Comment avez-vous divisé le travail ?
Victor Arregui : Eh bien, il y en a un où je suis le personnage principal, donc quelqu’un devait me diriger dans cette partie documentaire, donc cette partie est couverte par Isabel. Et la partie de mise en scène plus fictionnelle, où j’ai plus d’expérience, a été faite par moi. Disons que nous avons mélangé ces deux langages : le langage fictionnel est là parce qu’il n’y a pas d’archives et que nous devons recréer les souvenirs d’une manière ou d’une autre ; nous avons décidé qu’une partie de l’histoire devait être racontée de cette manière, et bien sûr j’aime la fiction, donc j’ai décidé d’écrire et de donner le texte à des acteurs et de réaliser l’ensemble sur la base d’événements majeurs ; et Isabel était chargée de la partie documentaire.
Oui, et dans certaines séquences, vous apparaissez à l’écran en train de diriger le film de fiction.
Victor Arregui : Oui, c’est la partie documentaire de la fiction. Il y a une troisième caméra qui couvre cette partie, ce que Laso “Coco” a fait, Daniel Avilés a fait la partie fiction et “Coco” enregistrait la façon dont on tourne un film, c’est-à-dire la séquence qui ouvre le film.
Oui, on dit que filmer le cinéma lui-même est l’une des choses les plus difficiles. Filmer un tournage, filmer comment un film est fait, a ses complexités, précisément parce qu’il y a plusieurs caméras impliquées et que tout peut devenir un abîme, une tâche sans fin. Je pense qu’il est également intéressant pour le public de savoir combien de temps a duré le processus de production de ce film ? Et comment avez-vous traversé les phases suivantes ? pré-production, production et post-production.
Victor Arregui : Vous voyez, nous avons commencé à la fin de 2016, au début de 2017. À partir de là, nous avons fait des allers-retours, qu’il s’agisse de documentaire ou de fiction, jusqu’à ce que nous décidions de mélanger ces deux langues. Et ça a pris beaucoup de temps, jusqu’à plus ou moins 2018 où on a présenté le projet à l’IFCI (Institut pour la promotion de la créativité et de l’innovation), je ne sais plus comment ça s’appelle, IFCI, ICCA, je ne sais plus, on a présenté à l’un d’entre eux et on a gagné. La dernière chose que j’ai faite était “El Facilitador” et nous l’avons présenté en 2014 (El Facilitador a été présenté en 2013), à partir de là, je n’ai rien fait pendant presque une décennie. J’étais heureux et là je reçois un appel, mais à la fin de 2018 nous l’avons tourné le premier trimestre de 2019. Le premier montage a été effectué par Carla Valencia, le deuxième par moi et le troisième par Isabel. Chaque processus a été respecté et cela nous a donné le film que nous avons maintenant. Mais c’est depuis 2016, c’est plus ou moins le cycle du cinéma en Équateur, 6-7 ans que nous avons pris. Dès que tu termines ton film ? Il faut attendre 7 ans pour en faire un autre, c’est le rythme absurde du cinéma dans ce pays.
Sept ans, c’est trop long, mais vous êtes un réalisateur qui a fait plusieurs films. Je pense que presque tous vos films sont des fictions, ou plutôt tous ceux que l’on peut voir sont des fictions. Où situeriez-vous ce film dans ce parcours que vous avez effectué ? Comment ce nouveau volet fonctionne-t-il dans l’univers de votre cinéma ?
Victor Arregui : En fait, mes films contiennent beaucoup de documentaire. Les lieux de tournage de presque tous les films que j’ai réalisés sont réels. En tant qu’acteur, je recherche aussi beaucoup plus de documentaire. Mais je pense plutôt d’un point de vue politique, je suis de gauche, donc mes films parlent de problèmes sociaux, de racisme, d’intolérance. Fuera de juego (hors-jeu) va avoir 20 ans, par exemple dans ce film il a été tourné pendant les soulèvements indigènes, donc nous avons utilisé des acteurs qui appartenaient au soulèvement, et ce n’est pas un documentaire, mais j’étais aussi dans le soulèvement des années 90, du parti communiste. Donc, plus que l’expérience, c’est surtout ce que je pense de ces films : Le Facilitateur, Hors-jeu. Et dans Quand ce sera mon tour, c’est ce que j’ai pensé d’un événement qui m’est arrivé, j’ai eu une crise cardiaque un lundi soir et j’ai pensé “il y a beaucoup de choses que je n’ai pas encore faites”, alors j’ai décidé de parler de la mort, pour en quelque sorte me débarrasser de ce sentiment de mort, enfin, je ne crois en rien, ni au ciel ni à l’enfer, mais il fallait se débarrasser de ce sentiment de mort que j’avais. Et il se trouve que j’ai lu le roman d’Alfredo Noriega alors que j’étais à l’hôpital, c’était un manuscrit ; c’était une coïncidence et c’était génial. Ce qui était difficile, c’est que cela plaise à Alfredo, ce qui est un engagement que l’on a avec son travail et son image. Donc je pense que chaque film a des séquences qui sont comptées pour arriver à El día que me callé, elles étaient comme sautant un peu à la fois, mais elles n’avaient pas, je ne sais pas, on me demande toujours pourquoi maintenant et je n’ai pas la réponse.
En parlant du contenu du film, avez-vous le sentiment qu’au point où vous en êtes aujourd’hui, où vous avez décidé de filmer, vous avez pu vous libérer, dans une certaine mesure, du machisme très présent dans notre société ? Comment surmonter ce machisme qui est si profondément ancré en nous et qui est souvent très difficile à surmonter et à dépasser pour les hommes aussi ? Alors, pensez-vous être moins machiste qu’avant ? Et aussi, comment confronter une société aussi machiste avec ce film ?
Victor Arregui : Je ne sais pas, c’est une des choses qui me fait un peu peur… ce n’est pas la peur, mais les réactions que ce film pourrait avoir dans une société machiste, comme vous dites. Je ne pense pas qu’on puisse guérir complètement, mais j’ai réalisé des choses, ce que tout le monde me dit “tu as réalisé des choses”, “tu as réussi à avoir une famille”, à avoir des enfants formidables, ils n’ont plus la puce du machisme et ils vivent dans une société machiste. Et je ne sais pas, je veux dire, je suis un gars privilégié, je sors dans la rue, je sors habillé comme je veux et personne ne me siffle, personne ne me regarde, je ne risque pas d’être une victime. Il y a beaucoup de privilèges dont nous, les hommes, bénéficions et il est très difficile, dans cette société machiste, de séparer ces privilèges que nous avons pour cesser d’être machistes. J’ai des trucs de macho, ce n’est pas facile de dire juste “ne sois pas macho” et c’est tout. J’ai honte de moi. Mais comme je l’ai dit, c’est compliqué, c’est difficile, je ne sais pas quelle réception ce film a dans cette société, ce qu’ils peuvent dire ; par exemple, je pense toujours à… parce que je suis âgé et qu’on me dit des choses différentes de celles qu’on diraient à une femme adulte si cela lui arrivait, non ? Et à un homme, si quelque chose comme ça lui arrive, on dit “pourquoi tu ne t’es pas défendu”, que tu es un lâche, mais comme il est établi ou normalisé que les garçons et les filles peuvent être abusés, ce n’est pas bien. C’est un exercice quotidien quand on a des enfants, n’est-ce pas ? Remplir son rôle de père, c’est-à-dire partager le temps, être chargé de changer leurs couches, les aider à faire leurs devoirs, c’est là que je pense avoir commencé à perdre un peu de machisme.
Le film se déroule dans le contexte d’un gouvernement qui a été reconnu comme autoritaire, où certains abus de pouvoir ont été commis, non ? Nous avons l’affaire Restrepo (un crime d’État, détention et disparition de deux jeunes frères ) ; mais en plus de cela, le film sort en 2022, juste au moment où la société équatorienne se demande ce qui se passe avec la police nationale en raison de l’affaire de l’avocate María Belén Bernal, qui a choqué l’opinion publique. Comment voyez-vous l’Équateur d’aujourd’hui, et les problèmes qu’il rencontre encore, par rapport à l’Équateur des années 1980 ?
Victor Arregui : Eh bien, je ne pense pas que cela ait jamais cessé de se produire. Toute notre vie, il y a eu des détentions et puis portés disparus, personne n’a pris la responsabilité de ceux qui ont disparu. L’autre fois, j’ai ouvert internet et j’ai vu des actualités de “portés disparus” “portés disparus” “portés disparus” …, et il y a toujours eu ces pratiques du pouvoir, peut-être dans certains gouvernements plus que dans d’autres, mais elles continuent à se produire. C’est aussi la raison pour laquelle j’ai décidé de faire ce film. Il y a toujours eu des disparitions, de beaucoup d’enfants dont nous ne savons pas où ils sont, mais les dossiers sont là, en attente.
Victor Arregui : Aujourd’hui, si le cas du médecin a de l’importance, c’est parce qu’il y a eu quelqu’un qui a dénoncé, et c’est quelqu’un d’important parce que sinon cela pourrait passer inaperçu, comme beaucoup de choses passeront inaperçues. Et c’est exactement pour cela que nous avons fait ce film, pour que ces choses cessent de se produire et qu’on en parle, pour qu’elles ne soient plus taboues, pour qu’on commence à en parler. Et je ne voudrais pas que le film soit utilisé comme un pamphlet politique, mais comme quelque chose de très profond, sur ce qui se passe dans notre pays, sur ce qui nous arrive, sur les raisons pour lesquelles on laisse ces choses continuer à se produire.
Quelles sont vos attentes vis-à-vis du public équatorien ?
Victor Arregui : Je n’en ai pas la moindre idée. Je ne sais pas quel effet peut avoir un film où un adulte parle de ce qui s’est passé quand il était mineur. Mais j’aimerais que cela cesse d’être un tabou, que nous commencions à parler, mais que nous commencions tous à parler, tous ceux qui sont touchés par les infections qui ont à voir avec les institutions cliniques privées, que nous commencions à parler de ce dont nous ne parlons pas. Que d’une certaine manière, ça cesse d’être normalisé. Là-bas, tous les jours, la plupart des gens s’en fichent, parce que ça a déjà été fait. Malheureusement, je pense que le machisme est si profondément ancré que ces films le rappellent, mais je ne sais pas jusqu’où ils iront. Ils diront “ça a été inventé”, “de quoi parle-t-il?”, “c’était il y a 30 ans, pourquoi en parle-t-il maintenant?”, ils vont essayer de le faire taire, de le nier. Mais franchement, j’espère que les gens qui parviennent à voir le film pensent que cela peut arriver à n’importe qui, à n’importe quel âge, n’importe où, à n’importe quel moment.
Dans le documentaire, vous parlez beaucoup du corps et de l’affect. Une phrase de Walter Benjamin, dit que “le corps est le réveil d’une douleur profonde et devient une pensée profonde “, dans vos films précédents, il y a ces murmures qui parlent de la violence de ce que vous avez vécu, et que c’est quelque chose que vous mentionnez dans le film autant que maintenant dans cet entretien. Après ce documentaire, après cet éveil du corps, quel serait votre nouveau regard cinématographique, pensez-vous pouvoir en parler d’une manière différente, comment l’aborderiez-vous ?
Victor Arregui : Très bonne question. J’aimerais faire un autre type de cinéma, mais je ne sais pas, j’écris un scénario en ce moment. Parce que je me demande toujours comment les films vieillissent, en fait, parce qu’il y a des films qui vieillissent bien et des films qui vieillissent mal. Et je pense que c’est là que ça se passe, je ne sais pas, je ne pense pas qu’il y ait beaucoup de machisme dans les films que j’ai faits, mais si vous les voyez, il se peut qu’ils n’accompagnent que les protagonistes masculins ; dans Fuera de juego (hors-jeu), c’est la femme du père qui se promène en l’accompagnant ; dans Cuando me toque a mí (Lorsque ce sera mon tour), c’est une fille qui accompagne Alejandro ; Et dans Le Facilitateur, il y a déjà un protagoniste qui affronte, qui cherche à égaliser les chances, mais je pense que dans la plupart des films que j’ai réalisés, malheureusement, les femmes accompagnent les personnages masculins ; et j’espère faire des films avec une perspective différente, où les femmes font partie de quelque chose, où elles n’accompagnent pas l’homme, mais ont leur propre rôle. C’est ce que j’espère.
Articles similaires
Partagez cet article